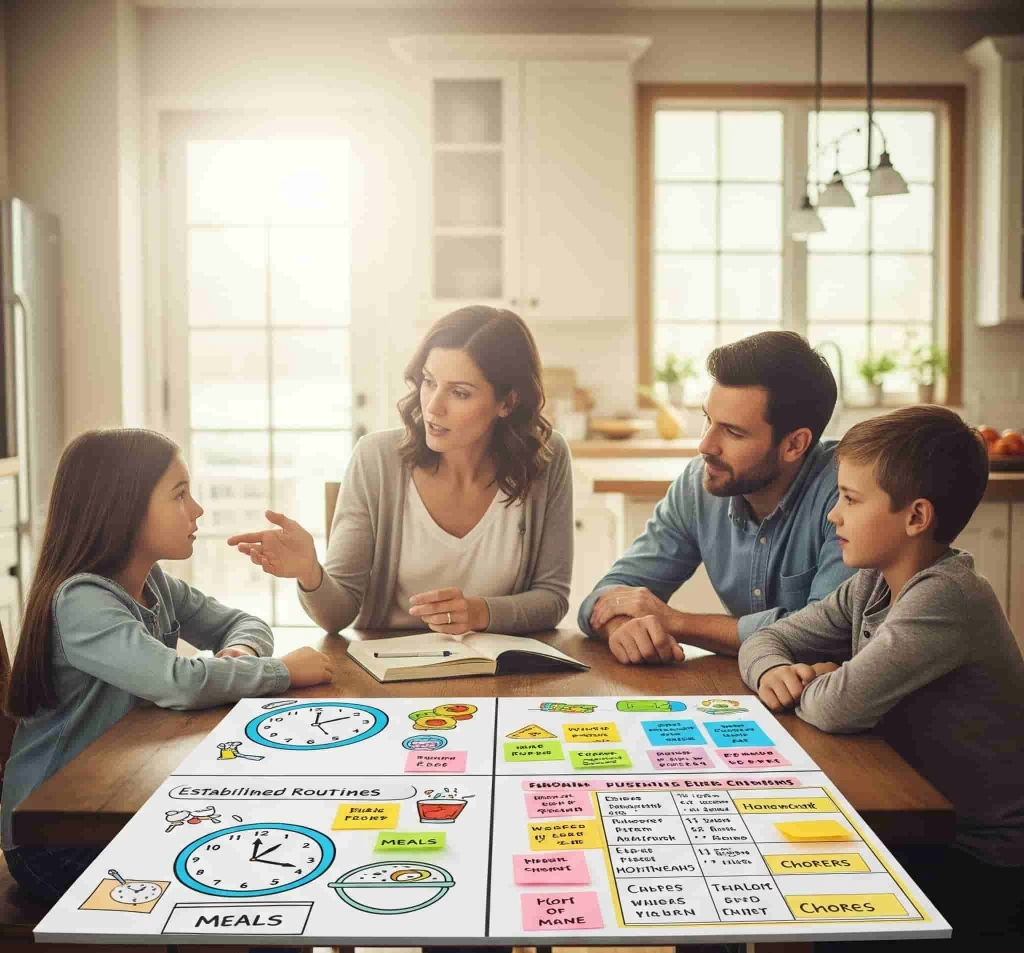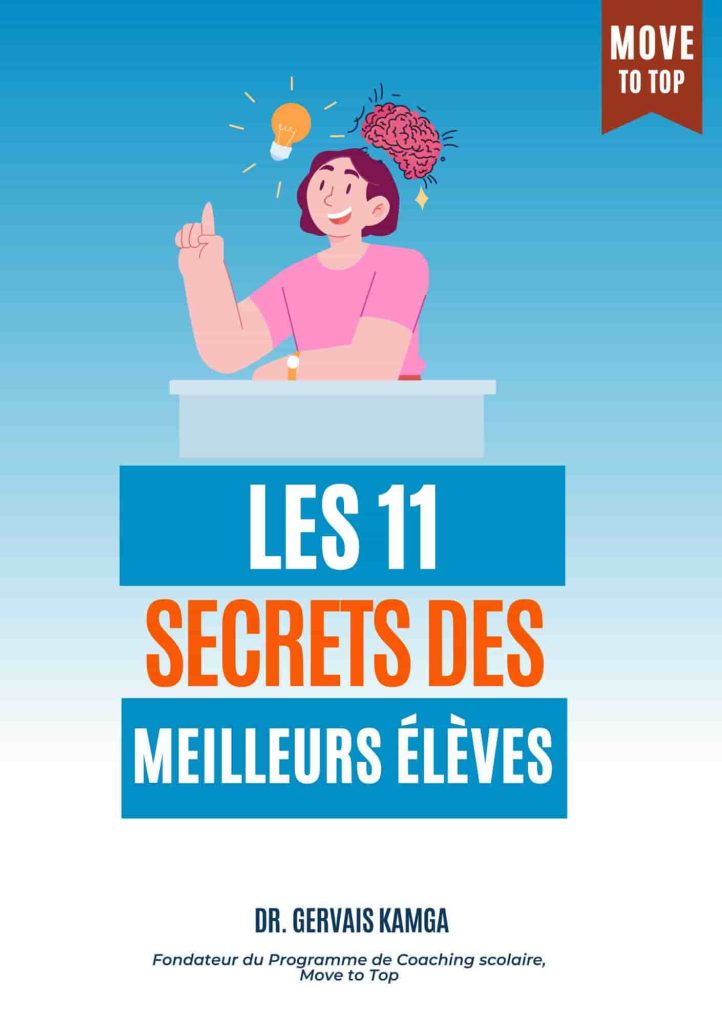Des parents démunis face à l’agressivité de leur enfant.
L’agressivité d’un enfant envers ses parents – en particulier envers sa mère – est un phénomène plus répandu qu’on ne le pense, bien qu’il demeure souvent tabou.
Des études indiquent qu’à l’adolescence, entre 3 % et 12 % des jeunes peuvent commettre des violences physiques sur leurs parents, et une proportion bien plus grande exprime de l’agressivité verbale envers les parents, et surtout la maman.
De nombreux témoignages illustrent la détresse de parents confrontés à ce problème :
Des Témoignages de Parents : «Ado Agressif Avec Sa Mère»
Une maman raconte que son fils de 18 ans la bat régulièrement, au point qu’elle exhibe « ses bras couverts de bleus ».
Il l’a même menacée avec un couteau, et elle vit désormais dans la peur permanente de le contrarier.
Dans un autre témoignage, une mère célibataire dit se sentir impuissante face à son fils de 16 ans : depuis quelques mois, il est « très agressif verbalement et vulgaire » envers elle, n’obéit plus du tout, fugue la nuit et l’agresse dès qu’elle essaie de lui parler.
Une autre mère avoue être « carrément à bout » devant la violence de son fils de 19 ans : « il me fait peur.
Quand il n’a pas ce qu’il veut, il pète un plomb et devient violent », explique-t-elle, décrivant une récente crise déclenchée par une simple remarque de sa fille cadette qui a dégénéré en altercation physique.
Dans ce cas, le jeune majeur a même tenté de se poser en victime à l’extérieur, allant se plaindre auprès d’institutions qu’il aurait été mis à la porte, alors qu’il logeait toujours chez sa mère – signe d’une manipulation qui désempare totalement la famille.
Certains parents envisagent des solutions extrêmes face à la montée de la violence. Sur un forum, une mère explique qu’elle en est venue à vouloir mettre dehors son fils de 17 ans tant il est devenu ingérable.
« Agressif, violent, [il] ne veut rien faire ni participer dans la famille… J’ai des enfants plus jeunes que je dois protéger… Il a beau commencer à me “battre”, c’est-à-dire me pousser – je me retrouve avec des bleus. […]
Je n’ai plus rien à faire et je veux garder ma santé », confie cette mère épuisée. Dans un tel climat, la cellule familiale vit dans la terreur.
Une belle-mère décrit une adolescente qui instaure un « régime de terreur » à la maison, défiant toute autorité, insultant sa mère devant tout le monde et n’ayant plus aucun respect pour sa sœur cadette.
D’autres messages révèlent que des mères seules, privées de soutien, sombrent dans le désespoir :
L’amie d’une maman violentée rapporte que celle-ci a eu des pensées suicidaires, se sentant culpabilisée et abandonnée par un mari constamment absent qui lui reproche « de n’avoir pas su élever [leurs] enfants ».
Des Témoignages D’agressivité Même Chez les Plus Jeunes
Il apparaît que tous les âges peuvent être concernés, même si l’adolescence reste une période particulièrement critique.
Des parents de jeunes enfants décrivent aussi des comportements tyranniques précoces.
Par exemple, certains enfants dès 7 ou 8 ans (et jusqu’à l’adolescence) multiplient les crises explosives et violentes à la maison, tandis qu’ils se montrent exemplaires à l’extérieur.
Les parents disent « marcher sur des œufs » en permanence pour éviter de déclencher la colère de l’enfant.
Ce profil d’« enfant tyran » – souvent observé chez des enfants très anxieux ou hyperactifs – est source d’une profonde détresse parentale, d’autant plus difficile à partager que l’entourage minimise souvent la situation.
« On ne s’attend pas à cela lorsqu’on fait des enfants… et pourtant, vous n’êtes pas la seule », rappelle avec empathie une internaute à une mère dépassée.
Ces témoignages, qu’ils concernent de jeunes enfants violents ou des ados agressifs, montrent des parents démunis, honteux d’admettre la situation, et qui cherchent désespérément des conseils pour réagir.
Comprendre les causes de l’agressivité filio-parentale
Plusieurs facteurs – individuels, familiaux et sociétaux – peuvent expliquer pourquoi un enfant ou un ado en vient à agresser sa mère. En voici les principaux :
1. La crise d’adolescence et la quête d’autonomie :
L’adolescence est une période de profonds changements psychologiques.
Beaucoup de spécialistes estiment qu’un certain degré d’opposition, voire d’agressivité, fait partie du processus normal de séparation d’avec les parents.
Comme le souligne le pédopsychiatre Daniel Marcelli, on observe des crises adolescentes « plus ou moins bruyantes et plus ou moins extériorisées, avec des passages à l’acte », qui traduisent un sentiment de toute-puissance et un besoin de s’affirmer.
C’est une étape délicate mais essentielle : un adolescent qui n’exprime jamais sa révolte risque de voir cette crise refoulée ressurgir plus tard à l’âge adulte de façon encore plus problématique.
Ainsi, une agressivité modérée peut simplement refléter la turbulence normale du « métier d’ado ».
Cependant, si cette agressivité devient extrême ou systématique, c’est le signe que d’autres causes sous-jacentes sont à l’œuvre.
2. Difficultés émotionnelles et troubles psychologiques :
Un enfant agressif est souvent un enfant en mal-être, qui gère mal ses émotions. Il peut exprimer sa colère, sa frustration ou sa détresse par la violence faute de mieux.
Les adolescents en particulier ont du mal à réguler leurs émotions et à les verbaliser de manière appropriée.
L’agressivité envers la mère peut alors servir de mécanisme d’adaptation au stress ou aux changements vécus, sans être un rejet profond de la mère elle-même.
Parfois, des troubles psychiques aggravent cette perte de contrôle : par exemple, un jeune atteint de schizophrénie non traité et consommateur de drogues pourra devenir extrêmement violent en situation de manque ou de crise délirante.
De même, un enfant en grande souffrance (dépression, anxiété intense, phobie scolaire…) peut exprimer son désarroi par de l’agressivité dirigée contre ses proches, fautes de savoir demander de l’aide autrement.
3. Contexte familial conflictuel ou insécurisant :
L’environnement familial joue un rôle majeur.
Des recherches ont montré que la violence des adolescents envers leurs parents est fréquemment associée à des conflits familiaux non résolus (disputes conjugales, climat de tension permanent) ou à des événements déstabilisants comme un divorce mal vécu.
Dans le témoignage d’Ingrid, sa fille est devenue agressive à 11 ans juste après le divorce parental, exprimant ainsi une profonde insécurité affective.
Par ailleurs, l’absence du père ou son désengagement peut priver l’adolescent d’une figure d’autorité structurante.
Une étude sur des jeunes placés en institution note que ces familles « matricentrées » avec une carence de la fonction paternelle et une mère isolée et dépassée sont un terreau fréquent de la violence filio-parentale.
Le jeune, n’ayant pas de référent paternel pour fixer les limites, cherche inconsciemment ces limites en poussant sa mère dans ses retranchements.
4. Antécédents de violence éducative :
Certains adolescents violents reproduisent un schéma de violence qu’ils ont eux-mêmes subi plus jeunes.
Une participante de forum rapporte qu’un grand adolescent qui battait sa mère avait en fait été élevé :
« à coups de gifles et de coups » durant l’enfance : « un juste retour des choses, finalement… » analyse-t-elle amèrement.
Sans généraliser, il est clair qu’un enfant ayant intégré depuis petit que « le conflit se règle par les coups » risque d’adopter ce mode d’expression plus tard.
À l’inverse, un laxisme excessif dans l’éducation peut aussi contribuer au problème : un enfant à qui l’on n’a jamais fixé de frontières claires peut devenir un ado qui ne respecte plus aucune règle.
Souvent, on retrouve chez ces jeunes une quête de repères et d’autorité jamais trouvés dans une éducation trop permissive.
5. Surprotection et inversion des rôles :
De nombreux cas d’« enfants tyrans » s’installent progressivement dans des familles où les parents, par amour, ont trop cédé ou « suradapté » leur comportement.
Par exemple, des parents très bienveillants face à un enfant hypersensible ou anxieux vont éviter toute contrariété à leur enfant… quitte à inverser peu à peu la hiérarchie familiale.
Le Dr Franc observe que ces parents, en voulant bien faire, mettent en place des stratégies excessives d’évitement des frustrations (par exemple, dispenser un enfant anxieux de cantine, de sorties ou d’obligations) – ce qui l’empêche d’apprendre à tolérer la moindre contrariété.
Résultat : l’enfant devient de plus en plus intolérant et exigeant, pouvant basculer vers un véritable comportement tyrannique.
Les parents se retrouvent piégés par leur propre surprotection : ayant « tout donné » pour apaiser leur enfant, ils n’osent plus rien lui refuser.
L’enfant, quant à lui, prend le contrôle de la maisonnée et répond par des colères violentes dès que quelque chose lui déplaît.
6. Manque d’attention ou jalousie :
Parfois, l’agressivité vise à attirer l’attention du parent. Un enfant qui se sent délaissé ou en insécurité affective peut adopter des comportements agressifs pour faire réagir sa mère.
L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur est un déclencheur classique : l’aîné, angoissé de perdre sa place, développe une colère dirigée vers le parent, faite de provocations et de « bêtises » destinées à redevenir le centre des préoccupations.
De même, un enfant ou un ado en manque de confiance en lui, qui se sent incompris ou rejeté, peut adopter la violence comme défense (« la meilleure défense, c’est l’attaque »).
En outre, certains témoignages laissent entendre qu’un adolescent peut chercher à tester l’amour de sa mère par son agressivité, comme pour vérifier jusqu’où elle continuera à l’aimer malgré tout.
Même si ce mécanisme n’est pas toujours conscient, la relation fusionnelle mère-enfant peut se tordre en un rapport amour/haine très intense à l’adolescence, où l’ado provoque sa mère tout en étant émotionnellement dépendant d’elle.
7. Influences des pairs, addictions et facteurs aggravants :
L’entourage extérieur de l’adolescent peut avoir un impact. La fréquentation de pairs déviants, l’usage de drogues ou d’alcool, peuvent amplifier l’irritabilité et lever les inhibitions qui retenaient l’ado de s’en prendre physiquement à ses parents.
Dans une famille recomposée, une mère décrit comment son fils de 16-17 ans, sous l’influence d’« amis » décrocheurs et consommateurs de cannabis, s’est mis à défier toute autorité et a même frappé son père lors d’une dispute – un dérapage qui l’a conduit temporairement en centre de détention pour mineurs.
Heureusement, ce choc carcéral a eu un effet salutaire : l’ado a reconnu qu’il avait « tout fait inconsciemment pour se faire mettre dehors – c’était son cri d’alarme ».
Enfin, d’autres facteurs modernes peuvent déclencher des crises de violence : l’addiction aux écrans ou aux jeux vidéo est souvent citée.
Un ado accro à sa console peut entrer dans des rages terribles si ses parents tentent de limiter son temps de jeu.
NB : Chaque situation est unique, mais il est important pour les parents de comprendre les racines du problème afin d’y apporter des réponses appropriées plutôt que de céder à la culpabilité ou au découragement.
Conseils et stratégies pour apaiser la violence et rétablir l’autorité parentale
Face à un enfant ou un ado agressif, les parents ne sont pas démunis : il existe des approches éducatives et des ressources éprouvées pour désamorcer les crises et restaurer une relation saine.
Les experts (pédopsychiatres, éducateurs) ainsi que l’expérience de nombreux parents confrontés à ces situations convergent vers un ensemble de bonnes pratiques.
Voici les principales stratégies recommandées – chaque conseil étant appuyé par la littérature ou l’avis d’un spécialiste :
1. Rester calme et garder son sang-froid face à la provocation.
Lorsque l’enfant explose de colère ou adopte un comportement violent, vous devez vous efforcer de ne pas répondre par la colère ni par la violence.
Il est crucial de ne pas réagir à chaud aux insultes ou aux coups, mais au contraire de prendre du recul.
Cela ne signifie pas tout accepter (voir point suivant), mais de ne pas hurler ni frapper en retour, ce qui ne ferait qu’escalader le conflit.
Un parent témoigne que, suivant les conseils d’un psy, il a appris à ne plus sur-réagir aux provocations de son fils ado :
Il n’intervenait que minimalement pour signifier son désaccord et assurer la sécurité en cas de danger, tout en rappelant à son fils qu’il l’aimait et restait disponible pour parler.
Avec le temps, dit-il, « les choses se sont calmées » et le dialogue a pu progressivement se rétablir.
Garder son calme permet de désamorcer bien des crises : cela coupe court à l’engrenage de la surenchère et montre à l’enfant que la violence n’est pas une solution.
2. Poser des limites fermes, cohérentes et non négociables.
Un enfant agressif a avant tout besoin qu’on lui (re)donne un cadre.
Il est indispensable de rétablir l’autorité parentale en fixant des règles claires et en les appliquant avec constance.
Il faut faire comprendre à l’enfant, « clairement et fermement… mais calmement », que son comportement est inacceptable et qu’il y aura des conséquences s’il continue.
Par exemple, on pourra établir qu’en cas d’insulte ou de coup, tel privilège sera retiré (reprendre le téléphone/tablet, sortie annulée, Wi-Fi coupé, etc.), de façon proportionnée et immédiate.
L’important est que ces règles et sanctions soient stables dans le temps et connues à l’avance pour ne pas tomber dans l’arbitraire.
L’adolescent, même s’il râle, est en réalité rassuré de sentir que ses parents tiennent bon sur certains principes.
Cette fermeté ne doit pas être confondue avec de la rigidité aveugle : il s’agit d’avoir une autorité calme, mais déterminée.
Un expert conseille aux parents de « se positionner en rocs », c’est-à-dire d’être solides sur leurs valeurs et interdits, car les adolescents « font leurs griffes sur nous, les adultes : si nous ne sommes pas solides, ils pataugent… ».
En pratique, cela peut signifier par exemple : « Je comprends que tu sois en colère, mais tu n’as pas le droit de frapper ni d’insulter. Si tu dépasses cette limite, telle conséquence aura lieu. »
Il faudra s’y tenir, sans faiblir face aux éventuelles manipulations ou menaces du jeune.
3. Ne jamais tolérer la violence physique et prévoir des mesures de protection.
Si malgré les avertissements l’adolescent en vient aux coups ou à la destruction, il est impératif que vous assuriez sa sécurité et celle des autres membres de la famille.
Cela peut impliquer, pour les cas graves, d’isoler le jeune violent (l’envoyer dans sa chambre pour se calmer, par exemple) ou de sortir soi-même de la pièce pour interrompre l’affrontement.
Il ne s’agit pas de capituler, mais de prévenir un mal plus grand.
Ensuite, à froid, des sanctions appropriées doivent tomber. Peut-être, saisir temporairement la console s’il l’a lancée à travers la pièce, proposer des travaux ménagers pour réparer les dégâts, etc.
Le Dr Franc explique que, en dernier recours, les parents peuvent prévoir une séparation temporaire – par exemple envoyer l’adolescent quelques semaines chez un proche ou dans un internat éducatif…
Afin qu’il comprenne que la famille ne peut plus vivre dans cette violence et qu’il ne peut pas « tout se permettre » impunément.
Le but de cette solution extrême est de confronter le jeune aux conséquences de ses actes et à le responsabiliser.
De même, déposer plainte n’est pas un tabou : si un enfant majeur frappe sa mère, celle-ci est en droit d’alerter les autorités.
La justice tend aujourd’hui à privilégier une réponse éducative (stages de responsabilisation, mise à l’épreuve avec obligation de soins, etc.) plutôt que la prison ferme.
Porter l’affaire devant un juge peut donc protéger la famille et forcer le jeune violent à se soigner.
En tout état de cause, ne pas subir en silence : il n’est « pas normal d’accepter » d’être frappé par son enfant.
4. Maintenir le dialogue et l’écoute, dans un climat d’empathie.
Restaurer l’autorité c’est une chose. Nous ne parlons pas d’instaurer un régime martial.
Au contraire, en parallèle des limites, il faut ouvrir des espaces de parole pour que l’enfant puisse exprimer autrement ce qu’il ressent.
Dès que le calme est revenu après une crise, il est bon de revenir vers lui pour discuter posément de ce qui s’est passé.
Prenez le temps d’écouter attentivement les préoccupations de votre ado et faire preuve d’empathie envers ses sentiments », ce qui peut grandement contribuer à apaiser les tensions ado mère-fils.
Concrètement, n’hésitez pas à organiser des moments de dialogue privilégié (par exemple, aller marcher ou prendre un café en tête-à-tête avec votre ado) – sans reproches pendant ce temps-là, juste pour l’écouter.
Montrez-lui que vous vous souciez de ce qu’il vit : « Je vois que ça ne va pas en ce moment, je suis là si tu as besoin de parler ou même de crier ta colère autrement. »
Cette disponibilité empathique, répétée sincèrement, peut peu à peu briser son isolement intérieur.
Enfin, pour les plus jeunes enfants qui n’ont pas les mots, on peut utiliser des moyens détournés pour les faire parler : le jeu de rôle, le dessin, les histoires.
Mettre en scène un conflit avec des poupées ou raconter une histoire similaire permet à l’enfant de prendre conscience des émotions en jeu et d’apprendre à les nommer, comme le suggère le Pr Marcelli.
5. Chercher du soutien et ne pas rester isolé.
Faire face seul(e) à la violence de son enfant est quasiment impossible.
Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l’aide, que ce soit dans l’entourage proche ou auprès de ressources extérieures.
D’abord, parlez-en à des proches de confiance : un membre de la famille, un ami, peut-être le parrain/marraine de l’enfant, etc.
Le simple fait de « sortir du secret » brise le sentiment de honte et peut apporter des idées neuves.
Parfois, la présence temporaire d’un tiers à la maison aide à calmer le jeu.
Sur un forum, on suggérait à une mère d’inviter un homme de la famille ; un oncle, un grand-père, etc.
À vivre quelque temps chez elle pour s’interposer physiquement et symboliquement entre le fils violent et sa mère, et « rétablir une relation acceptable » jusqu’à ce que l’adolescent comprenne qu’il ne peut plus faire la loi.
Cette approche rejoint les recommandations de la méthode de résistance non-violente développée par le psychologue Haim Omer:
Il conseille aux parents d’organiser un « réseau de soutien » autour d’eux, composé de proches informés de la situation, qui pourront intervenir en cas de crise et même signifier à l’adolescent toute la désapprobation du cercle social face à son comportement.
En parallèle, ne tardez pas à consulter des professionnels : votre médecin traitant, un(e) psychologue ou un(e) conseiller(ère) familial(e).
Il existe en France et au Québec des structures comme les Écoles des parents et des éducateurs, ou des services sociaux en mairie, où l’on peut trouver une écoute et des conseils gratuits.
Des parents dans la même situation s’y expriment et des spécialistes les guident (par exemple sur la dépendance aux jeux vidéo, la gestion des crises, etc.).
Vous n’avez pas à avoir honte de demander de l’aide : Ce genre de comportements est peu connu, même au sein du corps médical.
Il n’est pas rare qu’on fasse des reproches aux parents plutôt que de leur proposer un soutien.
Or il existe des professionnels formés pour cela : pédopsychiatres, psychologues, médiateurs familiaux… Ils pourront évaluer la situation de votre enfant et vous proposer un accompagnement adapté.
En conclusion
Ce n’est pas de votre faute. L’agressivité de votre ado ne signifie pas que vous n’avez pas su aimer ou éduquer – contrairement aux idées reçues culpabilisantes.
Face à un ado agressif avec sa mère, la clé réside dans un équilibre entre fermeté et bienveillance. Alors il faut rétablir l’ordre et la sécurité tout en gardant le lien affectif.
La route peut être longue et semée de rechutes, mais avec le soutien approprié et des stratégies cohérentes, beaucoup de familles parviennent à surmonter cette crise.
Chaque petit progrès compte : en appliquant les conseils des experts et en vous faisant accompagner, vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver un climat familial apaisé et aider votre enfant à grandir sans violence.
Courage, vous n’êtes pas seul·e dans cette situation et des solutions existent.